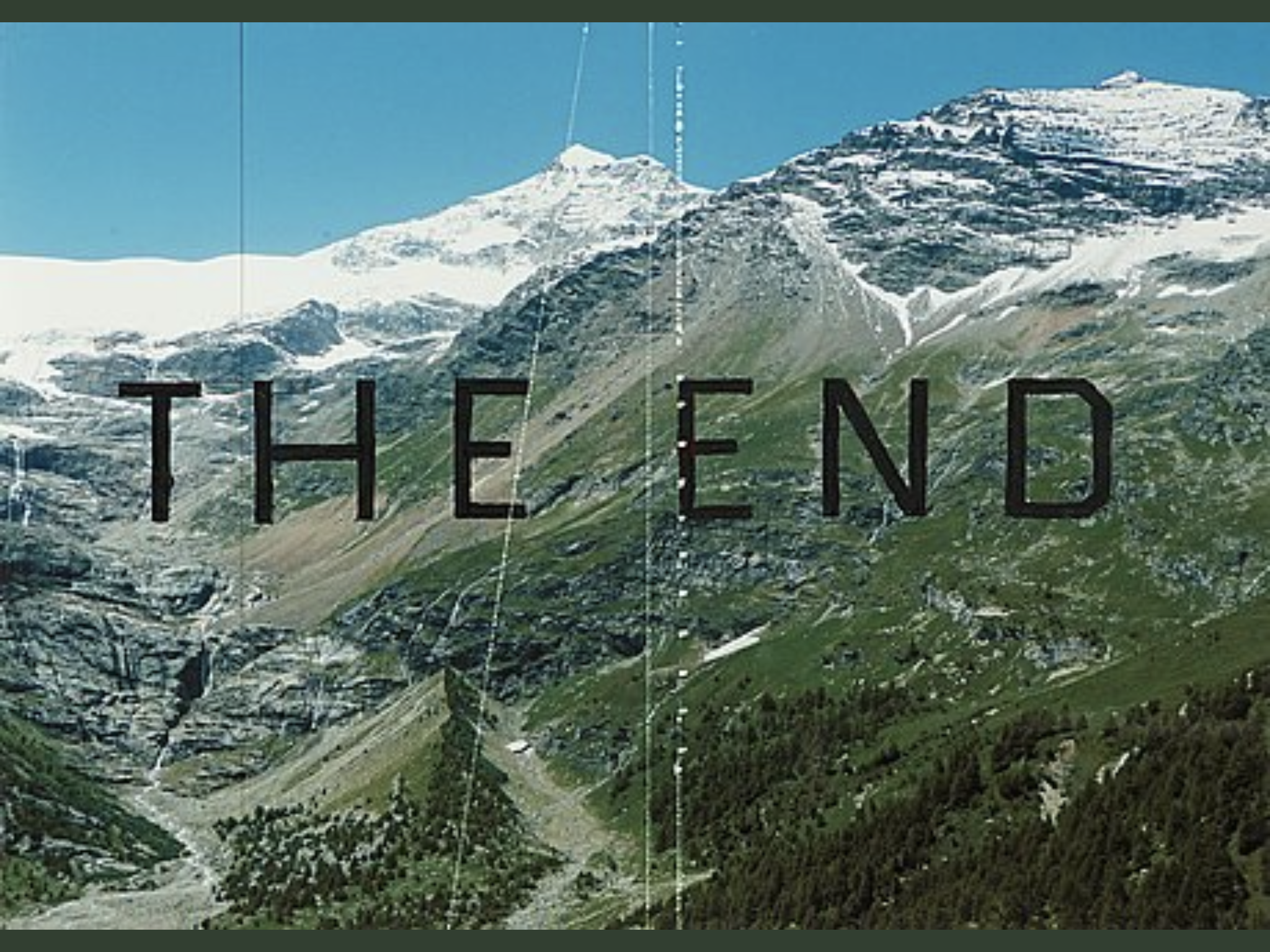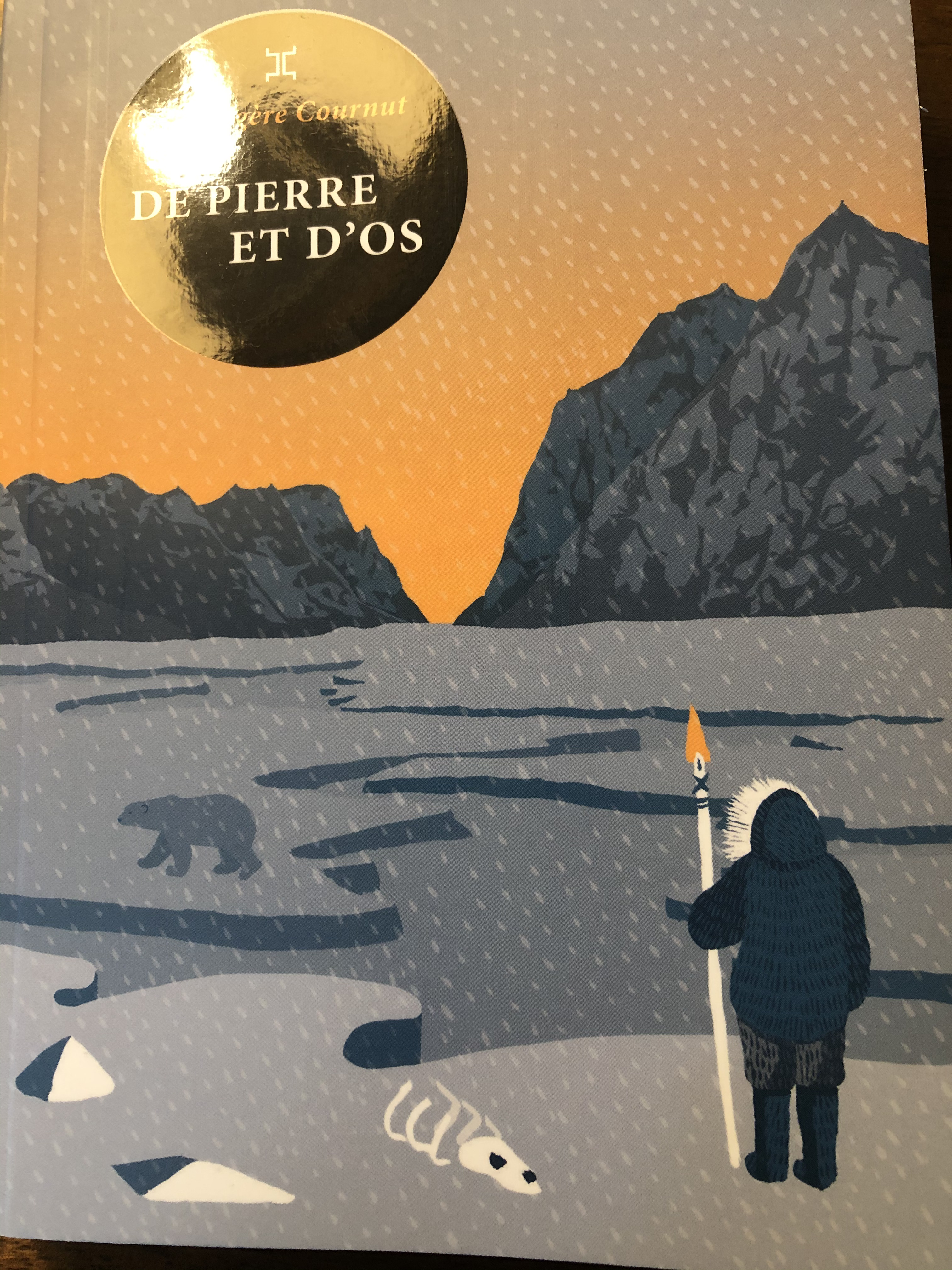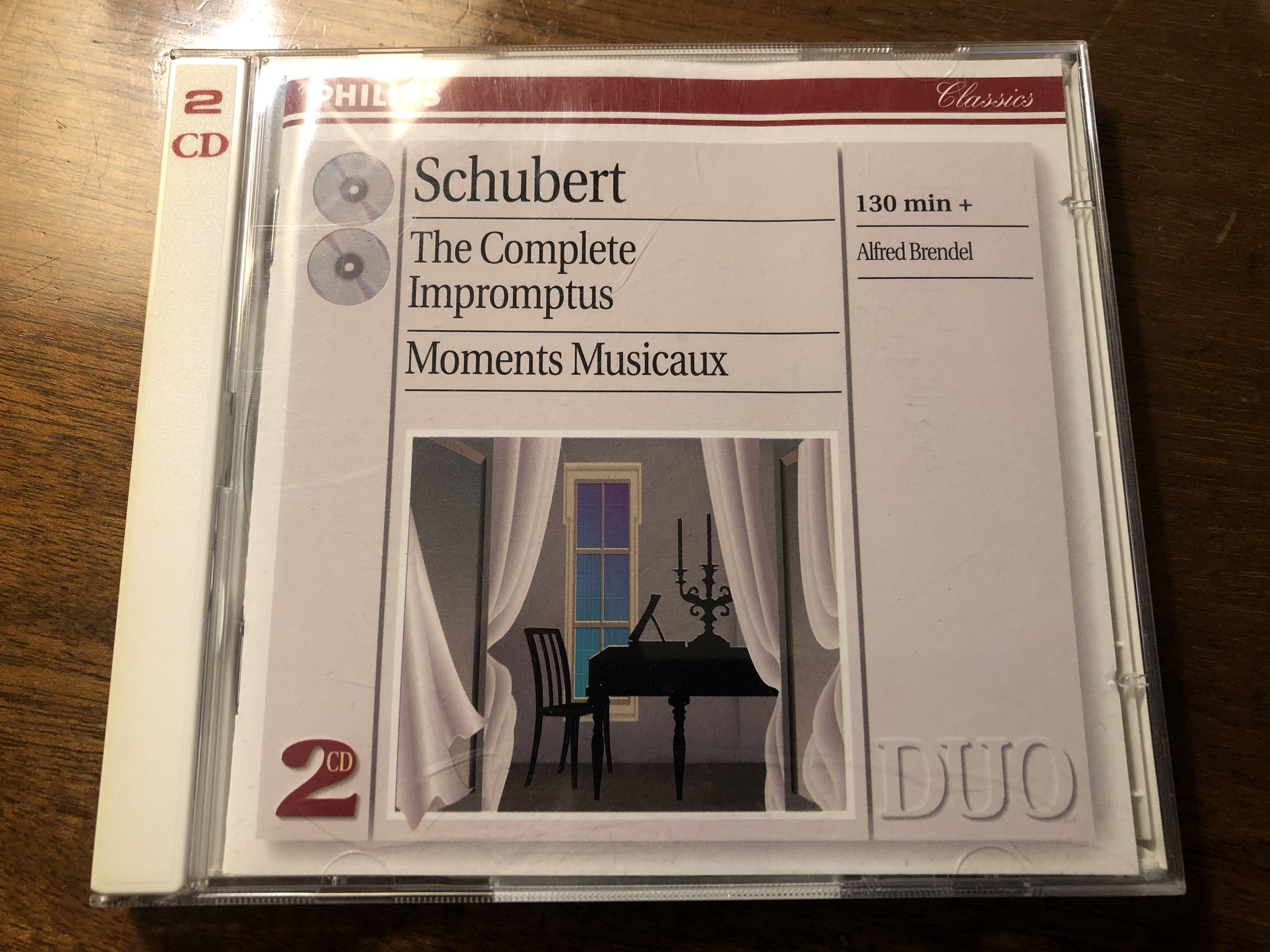Une île sur la lointaine mer petite. Elle nous attend, au sud de la terre où finit la France, là-haut à gauche sur la carte. Plein nord-ouest. Plus qu’un bon quart de journée à rouler vers elle, à l’imaginer trempée de pluie et secouée de rafales, comme souvent en terre bretonne. Je me souviens d’un jour de tempête sur Brest, il y a quelques années mais je n’oublie point de me méfier des clichés. À l’arrivée sur l’île, les gouttes sont timides et le vent bien présent oui, mais pas de quoi faire voltiger les casquettes et claquer fort les haubans. L’air offre une improbable douceur. Un petit bateau blanc et bleu foncé en bout de quai. Le temps de caler mon violoncelle à l’abri des embruns et le voyage commence vers la perle de la mer petite. Prenons place dehors, côté poupe. Une demoiselle en pantalon de ciré et bonnet rayé contrôle les billets. Une îlienne à chapeau se délasse à tribord. Un monsieur à la barbe rousse tire sur son court cigare. Le sillage d’écume trace une frise argent, comme un mascaret fuyant. Le courant freine le bateau. Il finit par se faufiler jusqu’à la cale du Port Blanc. En trois minutes, même pas, nous voici rendus sur l’Île-aux-Moines. Izenah en langue bretonne.
Cette langue, comment sonne-t-elle sur ses terres ? Impatience de l’entendre raconter des histoires de marins, de cabotage, de pêche et de fortunes de mer. Tenter de dénicher dans les ruelles du bourg et sur les chemins côtiers un possible écho vivant de ce parler qui sonne doux et âpre, rude et suave, rocailleux et aiguisé, à mes oreilles de Provençal. Au bout de la Pointe de Brouel, rencontrer Noël, la soixantaine barbue et moustachue, l’œil rusé de corsaire, près de dix années dans la Royale à arborer le drapeau breton sur sa tenue de matelot et à purger des semaines de trou. L’écouter raconter que la langue de ses ancêtres, il la comprend couci-couça mais ne la parle pas. Personne ici ne la parle plus à cause des Français. À l’école de la République, les élèves se faisaient taper sur les doigts lorsqu’ils parlaient la langue de leurs parents et grands-parents. Du coup, la transmission s’est tarie. Ma Mémé Zoé vécut cette injustice-là dans son Haut-Var natal. Ne pas rester sur la tristesse du constat. Se tourner vers les trésors silencieux offerts par Izenah. Tous parlent la langue de la lumière et de la mer.
L’Île aux Moines est la plus grande île du Golfe de Morbihan. Ce caillou de navigateurs et de pêcheurs n’a jamais accueilli de monastère. Elle tient son nom de la croix qu’elle dessine sur les flots lorsqu’on la regarde du ciel. Depuis la terre, c’est un désir de marche et de respiration qu’elle fait naître, cette croix biscornue. Avancer du père au fils et du Saint-Esprit jusqu’à amen. L’île nourrit aussi une envie d’approcher le langage des oiseaux.
Quitter l’île et emporter dans sa besace quelques mots découverts au fil de lectures. Brig, brigantin, senault, chasse-marée, lougre. Ce sont des bateaux. Ormeau, praire, patelle, vernis, poucepied. Ce sont des coquillages. Et puis six mots bretons : mor bihan, mer petite. Bro gozh ma zadoù. Vieux pays de mes pères. C’est ainsi que se nomme l’hymne national de la Bretagne.
Bro gozh ma zadoù – Alan Stivell, Gilles Servat, Tri Yann, Louis Capart, Soldat Louis, Renaud Detressan, Gwennyn, Clarisse Lavanant, Rozenn Talec & Cécile Corbel