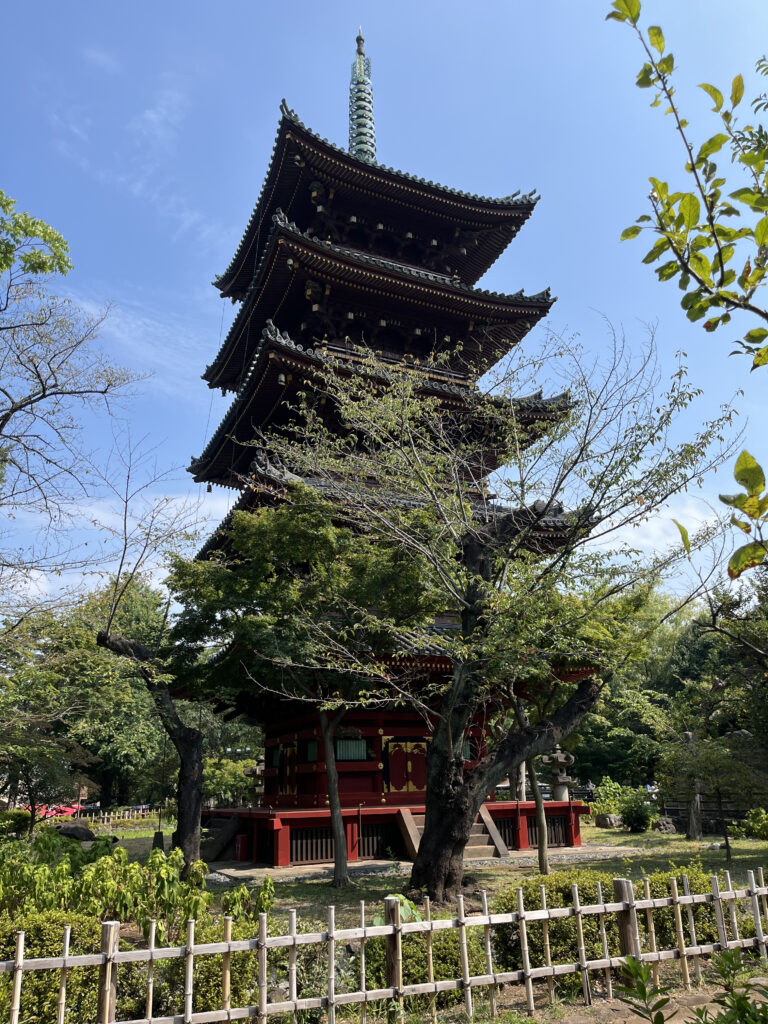Au pied de la Tokyo Skytree, dans le centre commercial Soramachi, そらまち, qui signifie ville du ciel, je tombe sur un petit robot mignon tout plein qui ressemble à un pingouin et vadrouille sur son présentoir. Yeux expressifs, peau en feutrine, il ne parle pas mais émet divers sons en déambulant sur ses trois roues motorisées. Le vendeur m’explique que ce robot est un Lovot et que sa mission sur cette terre est de générer de l’affection, voire de l’amour, d’où son nom. Ses circuits électroniques produisent de la chaleur sur son ventre, ce qui incite le ou la propriétaire à le prendre dans ses bras et à le câliner. Juchée sur sa tête, une excroissance oblongue intègre des capteurs et des caméras qui lui permettent d’identifier la personne qui se trouve en face de lui et d’analyser son environnement sonore. Je me suis hasardé à lui dire hajimashite, はじめまして, ravi de te rencontrer, il m’a à peine calculé. Il paraît que Lovot rigole quand on le chatouille et s’endort lorsqu’on le berce. Je n’ai essayé ni l’un ni l’autre, sans doute trop européen pour ce robot japonais héritier d’une tradition ancrée de longue date sur l’archipel.
(… à suivre)