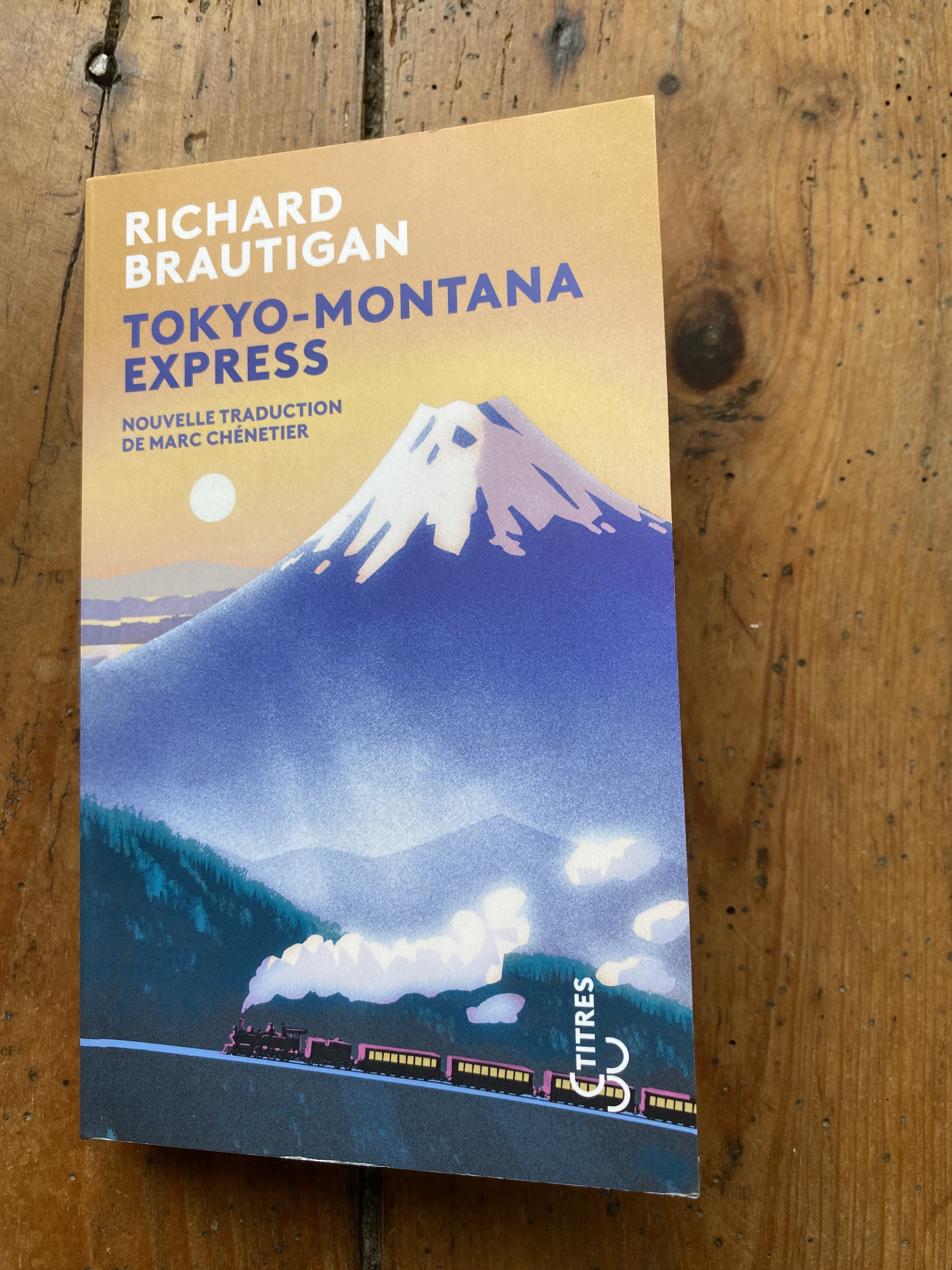Umarell. J’ai découvert ce mot l’autre jour sur Twitter. Ne l’avais jamais entendu, mais il me plaît car avec ses deux « l ». Il sonne comme un mot catalan, un terme de la grande famille de l’occitan. En fait, Umarell vient du dialecte populaire de Bologne et décrit les hommes retraités qui passent leur temps à observer les chantiers de travaux publics, les mains jointes dans le dos.
Mon Pépé Paul – décédé en 1990 à l’âge de 90 ans – fut un vrai Umarell marseillais Je me souviens de ses escapades quotidiennes en trolley dans les années 60-70. Avec sa carte de la RATVM* au tarif retraité, il sillonnait Marseille de ligne en ligne et de chantier en chantier. Tunnel du Vieux-Port, construction du métro, rien ne lui a échappé. Au repas du soir, il nous faisait un récit détaillé de ses découvertes. Parfois, au lieu de m’accompagner à la mer ou de m’emmener à la pêche, Pépé me conduisait sur l’un des chantiers qui lui faisaient tant briller les yeux. Nous restions deux trois heures à bader le ballet des ouvriers sur les marteaux piqueurs, les grues et les pelles mécaniques. Je me souviens que nous ne disions mot devant ce spectacle et qu’au bout d’un moment, sentant que je fatiguais et me lassais sans doute un peu, il me lançait en roulant les « r » – allez Érrric, c’est l’heurrre de rrrentrrrer !
Les chapacans qui nous gouvernent ne sont pas à une vilenie près : ils viennent de décider que c’est désormais à 64 ans, pas avant, que les travailleurs pourront partir à la retraite et donc entamer, s’ils le désirent, une carrière d’Umarell. Je ne vois guère qu’une grève générale pour tenter d’empêcher ces nuisibles de continuer à bousiller la vie des gens.
*La RATVM, Régie autonome des Transports de la Ville de Marseille, est l’ancêtre de la Régie des Transports de Marseille, aujourd’hui Régie des Transports Métropolitains
Photo d’illustration @Wikipedia : le trolleybus de la ligne 63 qu’empruntait mon Pépé au départ de chacun de ses périples. Il montait au Terminus Église d’Endoume près duquel nous vivions.