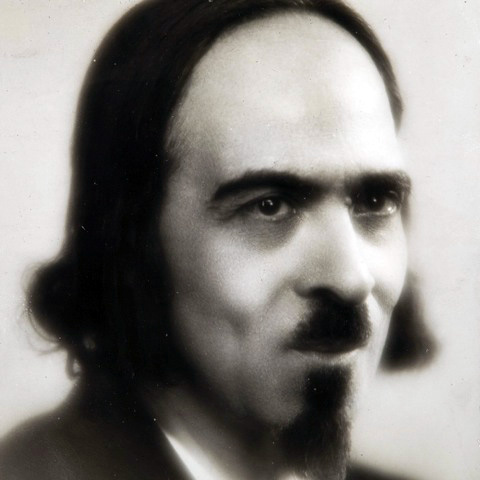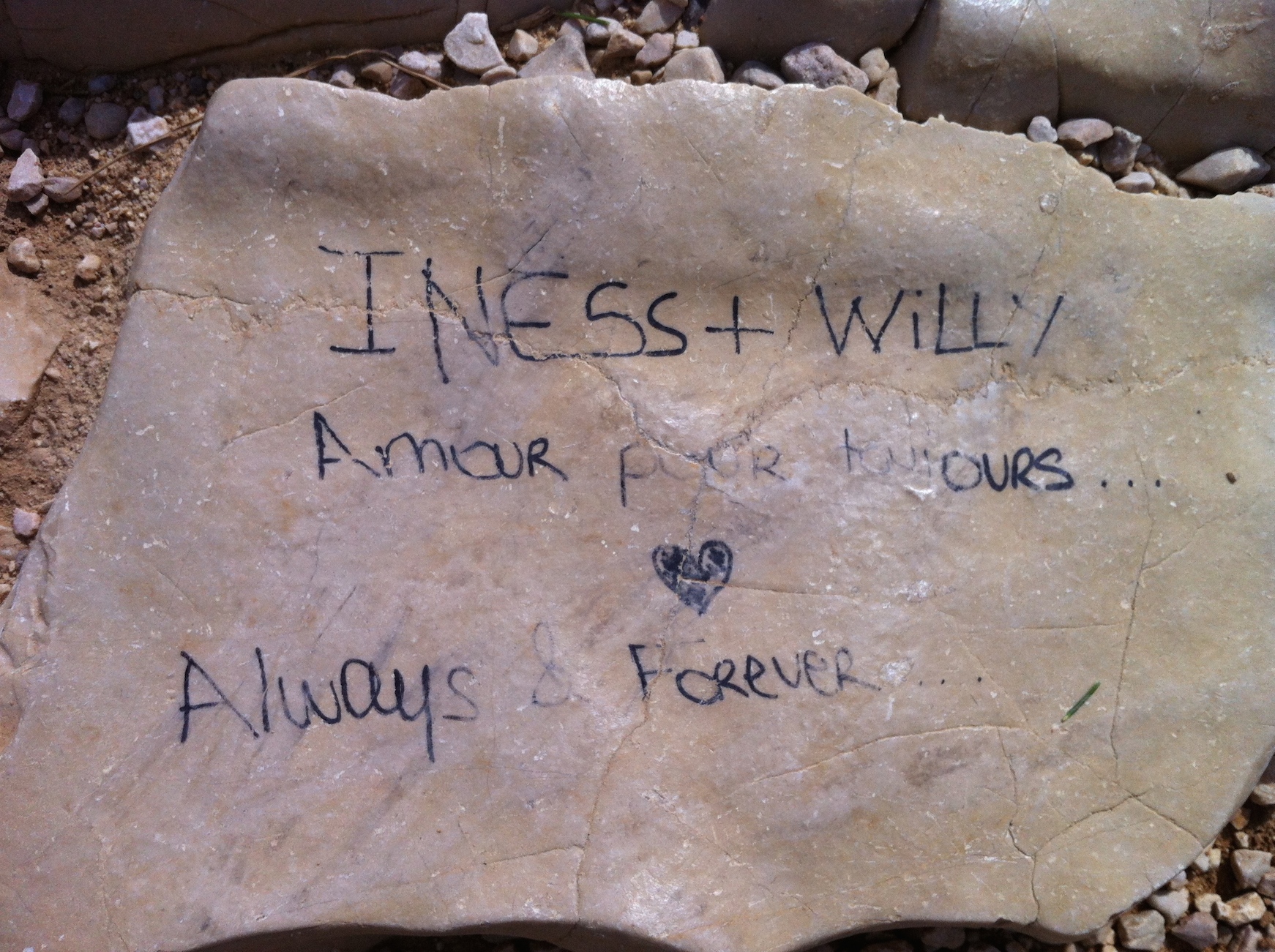Plus que trois minutes, Monsieur Arthur !
Le milicien qui nous surveille depuis le crépuscule tient les comptes à jour.
Sablier en main, il semble guetter avec fébrilité l’instant “ T “.
La fraction de seconde où le dernier grain rejoindra la meute au fond du cône en verre et sonnera le glas de nos retrouvailles.
Toi mon coeur, tu as installé en douceur ton nid au creux de mon cou, contre ma clavicule.
Mon épaule épouvantée par le compte à rebours, tu l’as tapissée de ton crâne aux cheveux chauds.
En sourdine, je claque déjà des dents. Tu souris comme à chacune de mes mimiques.
Tu n’as remarqué ni les menottes ni les armes. Tant mieux, je me dis. Tant mieux.
Il me revient le temps des premiers étonnements.
Après ta nuit ou juste derrière ta sieste, tu écarquillais tes billes comme une assoiffée de monde.
De tes bras et de tes pieds, tu inventais ton rythme, tu créais ton propre espace.
J’avais du mal à suivre mais je t’encourageais. Je t’applaudissais.
Bravo mon amour, je te murmurais dans le cou et contre les joues.
Pour que tu frissonnes. Et tu frissonnais en éclatant de rire.
Pendant toutes ces années-là, nous n’avons presque fait qu’un, ma belle.
Malgré les longues heures où mes rondes nourricières m’éloignaient de tes babillements.
A peine accouchée, ta mère s’était mise hors circuit dans l’exil au Brésil.
Sans un mot, sans prévenir.
Au fil du temps, tu avais fini par accepter de ne la connaître jamais.
Et puis a sonné l’heure de notre cavale.
Elle s’est enclenchée lorsqu’ils ont inventé la riposte suprême.
L’implacable réplique qui cloue le bec.
L’arme absolue qui dévaste pour la vie.
Automatiquement privé d’enfant. Tarif applicable à chaque “parasite”. C’est ainsi qu’ils nous nommaient, nous, les dépossédés de
tout. Les damnés de la croissance. Les exclus des agapes boursières. Les désespérés de la rentabilité.
“Le bagne moderne, ça va les faire réflêchir”, ils disaient à la radio.
Les télés reprenaient. Les journaux relayaient. Sans sourciller. Titres larges et papiers grassouillets.
Toi, tu ne savais pas encore lire l’alphabet.
Dès lors, je t’ai emmenée partout.
Dans les campagnes et dans les ports.
Bien à l’abri des remous et des sursauts.
A chaque fois loin de Marseille.
Décidé à t’épargner les tracas de la traque.
Soucieux de t’éviter le remue-ménage quotidien des déménagements.
A chaque jour, un programme sur mesure.
Point d’école, point de discipline, point de règle ni de cahier. Juste quelques grappes de jeux et d’exercices pour que tu apprennes
à grignoter la vie, à cheminer à ton allure, de tes petits pas de poupée.
Tu en redemandais.
Tu étais ma reine hilare et sereine, ma bobine de coton doux, ma pêche de vigne, mon joli scoubidou.
A la fonte de mes ultimes économies, j’ai commencé à multiplier les randonnées nocturnes.
A la recherche de quelque liasse embusquée dans les beaux quartiers. La dîme révolutionnaire, j’appelais ça.
Papa va prendre l’air en cyclo, je te disais, sac au dos et casque au poing. Il fait trop froid et trop noir pour te chaler.
Toi, tu comprenais.
Tu patientais au creux de ta couette et je te retrouvais anéantie de sommeil, le front reposé et les yeux dédiés à tes rêves.
A peine éclairée par la timide veilleuse que je t’avais laissée. On ne sait jamais.
Une nuit, j’ai bien cru qu’ils t’avaient enlevée.
Personne dans le lit.
Rien qu’un mot déposé près de l’oreiller : « Adieu, Arthur ! Surtout, ne perdez pas de temps à tenter de la rechercher. Votre fille est déjà loin, très loin. »
Anéanti, il m’a fallu passer la tête sous le robinet de l’évier pour réaliser que je venais de cauchemarder.
Trop d’alcool dans les veines.
Je m’étais affalé sur le canapé de la cuisine à peine franchie la porte d’entrée. Ivre mort.
Toi, tu n’avais pas cassé ta nuit d’un millimètre, mon ange.
Les bras en croix et les poings serrés, tu dormais profond, à peine agitée de ci de là par quelque songe.
Ce rêve mauvais m’a propulsé vers la peur violente de te perdre.
Mes esprits retrouvés, j’ai décidé de ne plus t’abandonner.
Je t’ai emmenée à chacune de mes virées.
Tu as donc commencé toute jeune à m’accompagner dans mes expéditions au pays des cuillères d’argent et des leçons d’équitation.
Ensemble, nous en avons remué des gentilhommières, visité des villas, escaladé des façades de palaces !
Lampe de poche en main, tu as vite appris à m’emboîter le pas, mon bijou.
A me prévenir par petits jets de lumière lorsque l’inquiétude te pinçait la joue.
A chaque fois, je venais te rassurer d’un clin d’oeil et d’un bisou et je repartais un peu plus loin, le sac en bandoulière, en quête de monnaie ou de trésor à négocier.
Peu à peu, nous sommes devenus somnambules. Mi chouettes, mi Belphégor.
Tu n’as plus fermé l’oeil avant les premiers rayons de soleil.
Nous avons vécu à contre-sens du reste du monde. Reclus dans le sommeil la journée, en éveil et en vadrouille le reste du temps.
Jusqu’au jour où tu m’as parlé de Marseille. Pour la première fois.
Tu voulais découvrir ta ville natale d’où j’avais dû t’arracher pour survivre à tes côtés.
Marseille, c’est impossible mon trésor. Trop dangereux, je t’ai expliqué. Demande-moi l’Amérique, l’Inde ou la Patagonie, mais pas Marseille.
Trop tôt, tu sais ? Il te faudra encore patienter.
Tu n’as pas insisté, mais tu t’es mise à m’ignorer non stop. Toute la sainte journée.
Indifférente à la moindre caresse, insensible au moindre mot gentil.
J’avais beau tenter de te dérouter de ton entêtement, je me heurtais à ta moue de tortue, à la transparence de tes yeux tristes.
Ce silence autiste m’est vite devenu intolérable.
En trois jours, il m’a fait basculer de l’autre côté et nous sommes rentrés.
Le lendemain du retour au quartier, les journaux titraient gros sur une rafle dans notre planque dorée sur la Côte.
Quelques heures de plus là-bas et nous serions tombés dans les rets de ces faces de rats.
A Marseille, tu as retrouvé un rythme plus rond, plus doux.
Finies les échappées nocturnes. Au placard les semelles de crêpe. Entre parenthèses les montées d’adrénaline.
Le portefeuille bien plein, je me suis déniché un pointu. Bleu ciel et blanc.
Nos semaines, nous les avons passées en mer, à caboter de crique en crique, de calanque en calanque.
Un été de rêve, à peine troublé par quelques journées de gros mistral. Pointu à quai et orgies de ciné.
Lorsque l’automne a poussé son souffle tiède sur la ville, tu m’as réclamé l’école. La grande école.
Celle aux cartables qui scient les épaules.
L’école des bons points et des récitations.
Tu a commencé aussi à vouloir un petit frère.
Tu t’es imaginée le rencontrer dans cette cour que tu me désignais avec gourmandise chaque fois que nous remontions de la mer.
J’ai résisté une semaine. Je t’ai couverte de jouets pour tenter de te distraire de ton projet.
Toi, tu as tenu bon, accrochée à ton idée, sans jamais renoncer.
Au fil des jours, tu t’es même hasardée à grimper sur le rebord des fenêtres de l’école, en imitant les élèves en train de compter à
voix haute ou de colorier leurs frises en silence.
Alors, j’ai craqué et je t’ai inscrite. Je ne me le suis pas pardonné.
Dès l’instant où tu as franchi le portail de cette communale, j’ai senti mes cellules se gorger de vide, ma peau se racornir, ma voix se rabougrir.
Il m’a fallu passer de longues heures face à la mer pour commencer à accepter le pas de deux esquissé par ton essor et par ma
chute.
Les premiers jours, j’ai bien failli venir te chercher en pleine classe.
J’ai renoncé à la tentation de nous rapter vers je ne sais quel pays où la vie aurait pu se redessiner comme avant.
J’ai résisté mais hélas, je ne me suis pas assez méfié.
Quelqu’un m’a dénoncé, je crois. Va savoir pourquoi.
Hier soir, devant l’école, un milicien en civil a attendu que tu sautes dans mes bras pour me faire signe de surtout rester bien sage.
Je l’ai suivi sans sourciller et nous avons atterri dans cette pièce humide où de la nuit, tu ne m’as pas lâché d’un millimètre.
– C’est fini, Monsieur Arthur ! Allez !
Face au sablier, j’ai beau agiter la tête en signe de refus, tu as beau hurler “mon papa, mon papa !” en t’aggripant à ma chemise
blanche, rien n’est plus fort que ce soldat qui nous arrache l’un à l’autre et te baillonne.
Vite, tu t’éloignes de bras en bras vers la porte d’entrée. Très vite même.
Tant mieux, je me dis, tant mieux…
A peine le temps de capter le claquement du chargeur et tu as disparu dans le fracas rougeoyant de ce matin d’octobre.