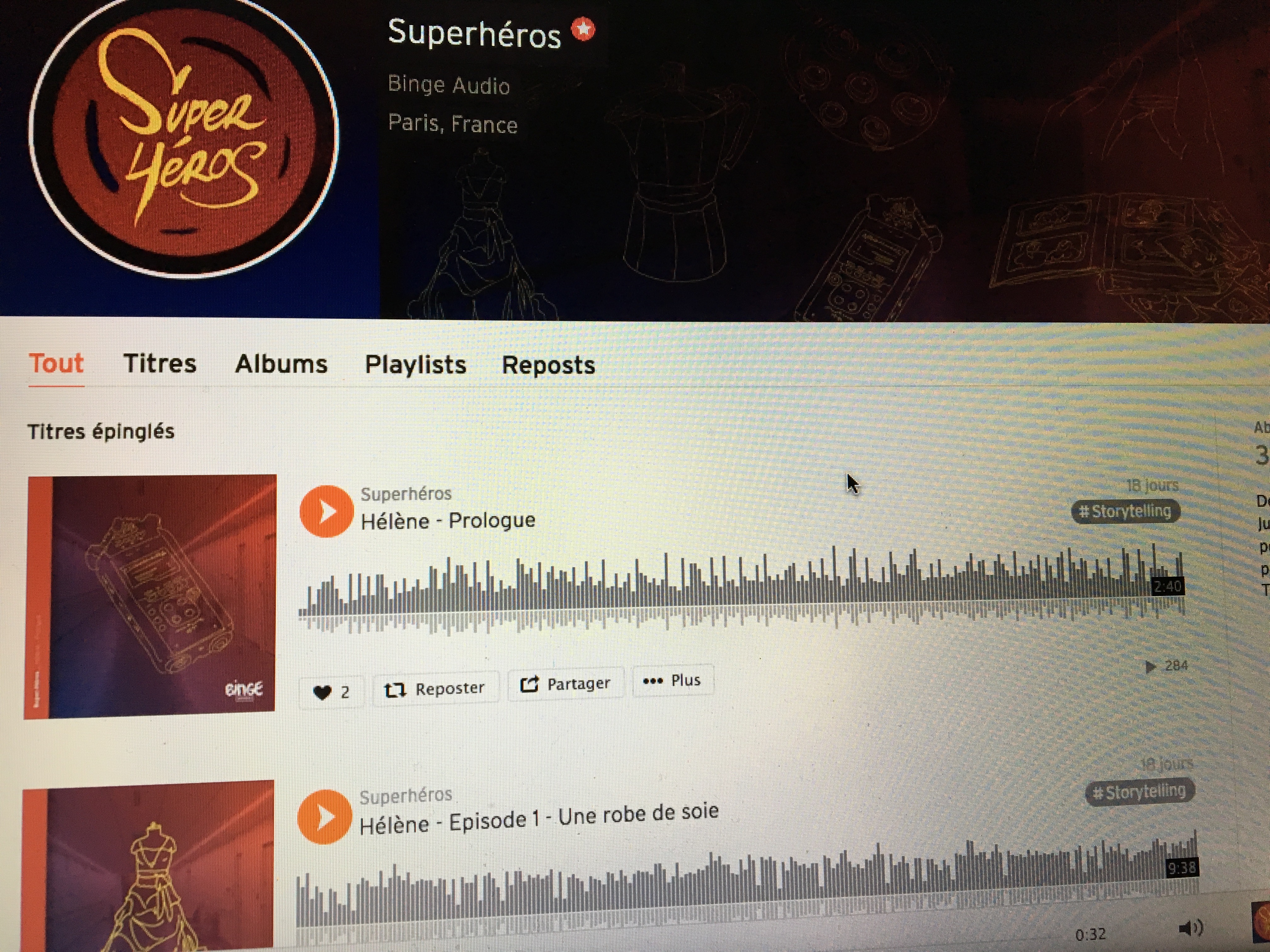Je baignais en plein “ Chloé meets Gershwin ” lorsque Lisa est venue me tendre un petit billet bleuté et parfumé en me chuchotant, la bouche tordue:
– Encore une cagole folle de toi, Oscar !
Du regard, je lui ai montré le rebord du Steinway. Elle y a déposé le papier cacheté et s’est éloignée furieuse vers le comptoir du piano-bar.
Lisa c’est ma serveuse préférée. Une de ces métis sensas qui swingue et suce comme une Rolls. Douce et dingue mais peu docile. Idéal pour ne pas se lasser.
Trois mois que nous nous connaissons, depuis mon arrivée à la “ Vierge Dorée ”, la cave à jazz la plus en vue de Marseille.
Le premier soir, dès que je me suis installé au piano, j’ai senti ses yeux violets posés sur ma bouche, là, tout contre mes lèvres.
– Un petit Mojito senor Oscar ?
Lisa me prend pour un émigré cubain. A cause de mon béret vert-olive, de ma peau mat et de mon faux air caribéen. Petite erreur de feeling mais je lui ai tout de suite pardonné. Le rhum et le citron vert la rendent très douce ma malgachine et si généreuse une fois notre journée terminée.
Je la trouve encore plus délicieuse depuis qu’elle vient me caresser les doigts lorsque je m’assieds à mon Steinway. Elle approche ses cils de mes joues et d’un sourire, me glisse qu’un petit massage ne me fera pas de mal.
– Ca va même vous porter bonheur, senor havanero !
Lisa me parle souvent espagnol. Elle a des mains d’accoucheuse et le bout des doigts bombé comme un dé de couturier.
La tête contre son épaule, je me laisse masser de la paume aux ongles. Pour saupoudrer la valse de ses pouces, elle m’offre aussi un zeste de son souffle teinté de Cuba Libre . Je le savoure, silencieux et apaisé.
Le problème avec Lisa, c’est sa jalousie aiguisée comme un Laguiole.
Elle ne supporte pas que les clientes me tournent autour et m’invitent à prendre un verre après le service. Aussitôt, les larmes la possèdent et dès que la caisse est bouclée, elle file s’enfermer dans son studio. J’ai beau lui répéter à travers la porte que c’est elle ma gâtée, ma préférée, mon caramel, Lisa se met minable. Je ne dois pas être assez convaincant. Pourtant, un double whisky avec madame avant le dodo, je trouve qu’il n’y a pas mort d’homme, moi.
Ce soir pas de surprise, à la “ Vierge Dorée “, c’est Bysance. Mado, la patronne, fait carton plein à chaque fois. Vingt ans que la monnaie tinte sur le comptoir cuivré.
Plus une place dans la grande salle aux baies vitrées qui ouvrent sur le port. Peu de connaisseurs et beaucoup de m’as-tu-vu. Jeunes bourgeoises à lévrier, rombières emperruquées à collier marseillais, veuves éteintes au nez refait, encravatés liftés avec maîtresse, intellos de broussaille avec minot. Je me pince, mais non, ce n’est pas un mirage, il y a même des enfants autour des tables du fond. Tandis que les parents bavardent, ils dégustent leur glace trois boules en boudant ferme, le menton calé dans une main, la petite cuillère en équilibre dans l’autre. L’ennui dégouline de leurs faces proprettes de gosses de riches.
Discrètement, je leur tire la langue. Avachie à la caisse, près de l’entrée, Mado n’apprécie pas trop. Elle serre les mâchoires en me menaçant d’un index tremblottant. Du coup, je calme le jeu et je déroule sur mon clavier. Souple et doux. “ Little piece in C for U ”. Le swing boulègue et je cherche à deviner qui a bien pu me faire porter l’enveloppe bleutée.
Lisa n’a rien voulu me dire d’autre que “ tu perds rien pour attendre” avant de s’immerger dans ses courses aux trois “C” : caisse, clients, comptoir.
Scotché au clavier, j’ai beau mener ma ronde vers les fourrures et les sacs en croco, les turbans en feutre et les diamants, chou blanc.
Aucun sourire aux commissures. Aucun clin d’oeil coquin. Aucun rond de main qui pourrait revendiquer le billet, à la dérobée.
Encore deux heures avant la fermeture. J’ouvre la parenthèse et me plonge encore plus profond dans la danse des touches, juché sur mon perchoir de star.
Le Steinway trône sur une estrade bleu-nuit, au carrefour des deux allées ouvertes par la salle conçue en “T”. La patronne m’aurait bien niché dans un coin près du pupitre à tiroir-caisse, le dos tourné aux clients comme mon prédécesseur, mais d’entrée j’ai refusé. Une place centrale, j’ai exigé. Avec une petite piste de danse dessinée en cercle autour du piano.
– Vous vous prenez pour qui ?, m’a lancé Mado très énervée.
– C’est à prendre ou à laisser, madame. Je ne jouerai pas confiné près du radiateur. J’ai passé l’âge du piquet, qu’est-ce que vous en pensez ?
Mado m’a montré la porte sans sourciller. Je lui ai dit au revoir sans un regard.
Une semaine plus tard, elle envoyait Lisa me déloger du “ Misty “, le piano-bar de mes débuts où je taquinais l’impro tous les matins.
A la “ Vierge Dorée “, Mado avait installé le piano au coeur du bar, encerclé d’une piste de danse en bois clair.
Mon show pouvait commencer.
Derrière mes Oakley argent, rien ne m’échappe. Je guette les rares sourires frais, j’épie les couples et m’amuse de leurs caresses contenues, de leurs disputes convenues. Parfois, je m’attriste des danseurs figés sur le parquet comme de la graisse froide. Le rythme les déserte. Ils se traînent à contre-temps, raides et pourtant si volontaires, si appliqués. Pathétiques pantins.
De temps en temps, j’observe le manège discret des sachets blancs échangés sous les tables contre des billets.
Ce soir, un dealer à costume vert s’agite dur entre le téléphone et le bar. Je ne le connais pas, ce marchand de cauchemar. Pourtant, j’en ai vu défiler en trois mois des petits vendeurs. Mado les tolère forcément. Ils tournent tous au champagne, à l’armagnac ou au Daiquiri.
Les plus assurés tombent leurs lunettes noires et s’ajustent le trois-pièces aux fenêtres du piano-bar, aimantés par leur reflet. Les plus inquiets ne s’asseoient jamais. Ils s’autorisent une pause éclair près du piano avant de s’en retourner au sauvage danger des rues abandonnées.
La “ Vierge Dorée “ est une escale fragile et calme qui brille pour tous et pour chacun. Même pour ces minots déjà centenaires tant ils promènent de poids aux épaules et de gris aux paupières.
Lisa ne les supporte pas, ne leur parle pas, ne les sert pas. Lisa les expulserait si elle s’écoutait.
Mais ce soir, ma malgachine a la tête ailleurs.
Elle surveille la pendule et m’ignore depuis l’engatse du billet. Même le tempo de mon “ Love you madly ”, à l’instant, ne l’a pas happée de son indifférence.
J’ai bien tenté de l’arraisonner en improvisant un “ Lover Man “ vigoureux façon Petrucciani, Lisa ne s’est pas déroutée de ce fil ténu et tendu qui la soutient pendant des heures du comptoir aux tables et des tables au percolateur. J’ai eu envie de ses lèvres et de ses dents contre mes mains.
Lorsque la petite aiguille s’est effacée au creux de la grande, je l’ai aperçue au pied du porte-manteaux, en grande discussion avec Mado. Ensuite, Lisa s’est enroulé les cheveux dans son keffieh et elle a filé sans se retourner.
Vous avez du miel au bout des doigts. Venez me rejoindre au Régent. Je vous attendrai chambre cent. A peine envolé le dernier morceau de la soirée, “ I didn’t Know about you “ – c’est toujours avec Monk que je prends congé – je décachète le billet bleuté. L’écriture est souple et délicate, mystérieuse et assurée. L’inconnue n’a laissé ni signature ni prénom mais ses derniers mots sonnent comme un aveu : Ne vous éternisez pas après Thelonius…
La gourmande est une habituée du piano-bar. Dans moins de dix minutes, je saurai si mes doigts ne tremblent pas.
Du brouillard sur les quais délaissés et au pied des grues rouillées. Sur le Chemin de la Vigie, je longe les ateliers éventrés, vidés de leurs machines. J’avance en terrain de connivence. Quinze ans à réparer les bateaux, ça donne quelques repères. Il y a plus pittoresque mais je déteste les cartes postales. Il y a plus court aussi jusqu’au Régent mais c’est le trajet que je préfère. Parce que le port est devenu un vestige à peine tiède, décoloré, presque anesthésié.
Vite, profiter encore un peu des hangars gris, longer les entrepôts au bord de l’eau, se laisser bouger par les courants d’air, deviner près des filins le cri des voix anéanties. Surtout, peser chacun de ses pas sur ce domaine massacré.
Car les nouveaux conquérants débarquent et s’installent et rêvent à voix haute de fortune en bord de mer. Accent pointu, costumes larges, attaché-case, anglais courant souhaité. Des casinos et des bureaux à la place des bateaux. Par milliers de mètres carrés. Les plans sont déjà prêts. Plans sociaux et plans fonciers. Un troisième millénaire pépère s’avance au rythme du dollar et des croisières.
A la lisière du Marseille encore intact, le Régent pointe vers le ciel ses trois étoiles. Larges fenêtres et balcons à la vénitienne. Pas de groom à l’entrée, il est trop tard. Pas de Luis non plus. D’habitude le veilleur m’accueille en baillant dans le hall devant sa télé. Là, il a dû monter aux étages faire sa ronde.
Ce soir, je ne prends pas l’ascenseur. La cent est au premier, juste en arrivant sur le palier. L’inconnue a laissé la porte entrouverte et a mis de la musique, valse et jazz mêlés.“ Romantic but not blue “ , un de mes morceaux préférés.
A peine à l’intérieur de la chambre, une ombre se jette sur moi et me cogne ferme à la tête. Je hurle et je m’éboule face à la baie vitrée entrebaillée.
Avant de m’évanouir, j’aperçois Lisa allongée les jambes offertes.
Les mains dans les cheveux, elle ordonne : – Viens vite mon Luis, viens me donner ton miel !
Lorsque j’ai rouvert les yeux, il faisait jour mais je n’ai vu que du rouge, enfin un peu de blanc aussi, le blanc de mes doigts tranchés éparpillés sur la moquette.
Plus de piano dans l’air, rien que le rire acide des mouettes.
* * *
Du miel au but des doigts est l’une des treize nouvelles de mon recueil « Marseille rouge sangs » publié l’an passé aux Editions Parole. C’est aussi l’un des trois textes du livre adaptés au théâtre par les comédiens de Base Art Compagnie. Dimanche-dernier, ils ont donné la douzième et dernière de leurs représentations du spectacle au Bar culturel de l’Angle, dans le cadre du OFF du Festival d’Avignon.
En Février prochain, leur Marseille rouge sangs devrait être programmé lors de la 6ème édition du Festival « Polar en Lumière » au cinéma Les Lumières de Vitrolles, lors d’une soirée « Marseille » à laquelle je suis invité aux côtés d’autres auteurs marseillais.